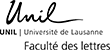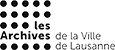Description du projet
Le droit naturel moderne
Publiée en 1625, l’œuvre majeure de Hugo Grotius, De jure belli ac pacis, marque un tournant dans la tradition du droit naturel. Elle fait de son auteur, au même titre que Thomas Hobbes et Samuel Pufendorf, l’un des fondateurs du droit naturel moderne. Cette discipline à la charnière de la philosophie et du droit, vise à expliquer systématiquement les droits et les devoirs de l’individu à l’état de nature, ainsi que dans la société civile. D’abord développée dans les pays protestants, puis dans les milieux catholiques, elle s’est progressivement étendue à toute l’Europe. Ses thèses, largement diffusées par les traductions et les commentaires des grands traités de ses fondateurs en langue vernaculaire, ont été enseignées dans les universités et les hautes écoles d’Europe et d’outre-mer. Au XIXe siècle, bien qu’encore enseigné, le droit naturel perd en influence et se voit en partie remplacé par la philosophie du droit. Présent dans des domaines divers, tels que le droit, la philosophie morale et politique, ainsi que les arts et la littérature, le langage du droit naturel a fortement imprégné la pensée du XVIIIe siècle. Certaines de ses doctrines sont considérées comme étant à l’origine des premières déclarations des droits de l’homme, et notamment de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
L’école romande du droit naturel
Les Républiques suisses ont joué un rôle particulièrement important dans la transmission et la vulgarisation du droit naturel au temps des Lumières. Le célèbre jurisconsulte huguenot, Jean Barbeyrac (1674-1744), a enseigné à l’Académie de Lausanne de 1711 à 1718. Lors de son recrutement, il était déjà connu pour ses traductions et ses commentaires des traités de Pufendorf, le De iure naturae et gentium libri octo (1672) et le manuel De officio hominis et civis juxta legem naturalem (1673). Le rayonnement de l’œuvre de Barbeyrac (→ projet LL "Correspondance Barbeyrac"), l’influence du droit naturel dans l’enseignement des Académies de Lausanne et de Genève, ainsi que l’importance de cette discipline dans les productions littéraires – en partie manuscrites – de l’époque permettent d’établir l’existence d’une véritable école romande du droit naturel.
Avec Barbeyrac, Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) et Emer de Vattel (1714-1767) comptent parmi les représentants les plus importants de cette école romande. Burlamaqui a enseigné le droit naturel à l’Académie de Genève de 1723 à 1739, en élaborant ses leçons sur la base de la traduction française du manuel de Pufendorf. Ses leçons ont été publiées en deux volumes, sous les titres de Principes du droit naturel (1747) et de Principes du droit politique (1751). Jean-Jacques Rousseau, son concitoyen genevois, reconnaît l’importance de ces traités dans la tradition du droit naturel, tout en critiquant cette dernière : il reproche à ses représentants de confondre l’homme naturel et l’homme civilisé. Vattel est quant à lui l’auteur d’un traité influent sur le droit des gens, inspiré des écrits du philosophe allemand Christian Wolff. Il a ainsi contribué à rendre ce dernier accessible à un public qui n’avait plus le goût de lire des traités volumineux rédigés en latin. Toutefois, en raison de l’importance que Vattel accorde à la souveraineté des Etats, Le droit des gens qu’il publie en 1758 constitue une véritable réinterprétation de l’œuvre de Wolff.
D’autres figures ont également contribué au rayonnement de cette école romande de droit naturel, à l’instar de Fortuné-Barthélemy de Félice (1723-1789). A l’Académie de Lausanne, c’est Charles Guillaume de Loys de Bochat (1695-1754) qui succède à Barbeyrac. Après lui y enseignent Béat-Philippe Vicat (1715-1770), Jacques Abram Daniel Clavel de Brenles (1717-1771), Christian Dapples (1740-1801), Henri Vincent Carrard (1766-1820), Charles Secretan (1784-1858), Charles Comte (1782-1837), François Pidou (1799-1877) et Charles Secretan (1815-1895), le neveu du précédent. On peut encore mentionner Gabriel Seigneux de Correvon (1695-1775), Jean-Georges Pillichody (1715-1783) et Samuel Porta (1716-1790), tous trois liés à l’Académie de Lausanne, sans y avoir directement enseigné.
A l’Académie de Genève, il faut relever, en plus de Burlamaqui, la présence de Philippe Reinhard Vitriarius (1647-1720), Bénigne Mussard (1657-1722), Pierre Mussard (1690-1767), Jean Cramer (1701-1773), Pierre Pictet (1703-1768), Pierre Lullin (1712-1789), Pierre Prevost (1751-1839) et Jean Antoine Cramer (1757-1818). Jean-Alphonse Turrettini (1671-1737) est aussi lié à la tradition genevoise du droit naturel. A Neuchâtel, l’enseignement du droit naturel est exercé par Louis Bourguet (1678-1742). Et, enfin, dans le canton pourtant catholique de Fribourg, trois professeurs dispensent des cours de droit naturel : Tobie Barras (1746-1813), Jean-François Ducros (1775-1824) et Jean-François-Marcellin Bussard (1800-1853).
Le droit naturel enseigné outre-Sarine
Le droit naturel fut également enseigné dans d’autres Républiques suisses. Nous avons notamment tenu compte de l’enseignement dispensé à l’Université de Bâle par Johann Rudolf von Waldkirch (1677-1757) et Andreas Weiss (1713-1792), à l’Académie de Berne par Johan Caspar Seelmatter (1644-1715), Gottlieb Jenner (1696-1774), Sigmund Ludwig Lerber (1723-1783), Daniel von Fellenberg (1736-1801), Karl Ludwig Salomon Tscharner (1754-1841) et Wilhelm Snell (1789-1851). Dans le contexte zurichois, nous relevons la présence de Johann Heinrich Schweizer (1646-1705) et de Johann Heinrich Heidegger (1663-1698), rattachés au "Carolinum", et de Hans Caspar Escher (1678-1762).
Sociabilité, égalité naturelle et inégalités sociales
Nous avons d’une part d’exploré les sources liées à l’enseignement du droit naturel en Suisse. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux leçons de Burlamaqui, dont les sources manuscrites n’ont encore jamais fait l’objet d’une étude critique. Nous nous intéressons aussi aux représentants moins connus de l’école romande, qui ont enseigné le droit naturel dans le sillage de Barbeyrac et de Burlamaqui, ainsi qu’à l’enseignement du droit naturel à l’Université de Bâle, dans les Hautes Ecoles de Berne et de Zurich et à l’Ecole de droit de Fribourg. Les découvertes les plus importantes – qu’il s’agisse par exemple de notes de cours ou de dissertations – sont publiées sur ce site.
Le projet suisse avait d’autre part pour but d'étudier la diffusion du droit naturel dans les Lumières suisses, françaises et écossaises. Le sujet qui nous intéresse particulièrement à cette fin est celui des relations au sein du foyer (entre époux, parents et enfants, maîtres et domestiques). Dans la tradition du droit naturel moderne, la famille est généralement considérée à l’état de nature comme une forme de société précédant la fondation de l’Etat. Les conceptions de la famille diffèrent, cependant, en fonction de la manière dont les penseurs conçoivent la nature de l’homme. Le choix de ce thème permet d’approfondir deux problématiques centrales des théories du droit naturel : celle de la sociabilité et celle de la tension entre égalité naturelle et inégalités sociales.
Remerciements
Nous remercions le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour le financement, ainsi que les institutions dépositaires des manuscrits, soit la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, les Archives cantonales vaudoises et la Bibliothèque de Genève.
Ce projet a été mené sous la direction de Simone Zurbuchen et avec la collaboration de Lisa Broussois, Justine Roulin et Aline Johner. La coordination sur Lumières.Lausanne a été assurée par Béatrice Lovis, qui a succédé à Séverine Huguenin.
Ce projet est la contribution suisse au projet de recherche international Natural Law 1625-1850, qui porte sur le droit naturel en tant que discipline académique. Tout en favorisant l’étude et la publication de sources locales inédites, ce réseau incite les équipes de recherche de différents pays à collaborer et encourage ainsi vivement les études comparatives et transversales.
Citer comme
Lumières.Lausanne, projet "Le droit naturel en Suisse (1625-1850)", dirigé par Simone Zurbuchen, Université de Lausanne, url: https://lumieres.unil.ch/projets/droit-naturel, version du 20 août 2018.
Références bibliographiques
Littérature primaire
-
De Felice, Fortunato Bartolomeo (dir.), Encyclopédie, ou Dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines, Yverdon : [F.-B. de Felice], 1770-1780, 52 vol.
-
, Réfutation de l'hypothèse de Mr. Loys de Bochat...: sur ce fameux cas de conférence, si un particulier peut s'engager au service d'un prince étranger..., Genève : François Jaquier, 1730, 60 p.
-
, Dissertatio inauguralis juridica De jure accrescendi quam exantlatis ex omnigena jurisprudentia quatuor examinibus rigorosis auctoritate, et consensu [...], Vindobonae : Literis a Ghelenianis, 1775
-
, Essays on the spirit of legislation, in the encouragement of agriculture, population, manufactures, and commerce, London : W. Nicoll and G. Robinson, 1772, 479 p.
-
, The Principles of Natural and Politic Law, Korkman, Petter (éd.), Nugent, Thomas (1700-1772) (trad.), Indianapolis : Liberty Fund, coll. Natural law and Enlightenment classics, 2006, 561 p.
-
, Principes du droit naturel. Nouvelle édition revue et corrigée, Genève, Copenhague : Cl. & Ant. Philibert, 1756
-
, Principes du droit de la nature et des gens. Avec la suite du "Droit de la nature" qui n'avait point encore paru. Le tout considérablement augmenté par Mr. le Professeur de Félice, Yverdon : [F.-B. de Felice], 1766-1768, 8 vol.
-
, Principes ou élémens du droit politique. Ouvrage posthume publié complet pour la première fois, Lausanne : François Grasset, 1784
-
, The Principles of Natural Law, Nugent, Thomas (1700-1772) (trad.), London : J. Nourse, 1748, 312 p.
-
, Traité du juge compétent des ambassadeurs, tant pour le civil que pour le criminel, Barbeyrac, Jean (trad.), La Haye : chez Thomas Johnson, 1723
-
, Principe du droit naturel traduit de l'allemand, Clavel de Brenles, Jacques Abram Daniel (trad.), Lausanne : chez J. Pierre Heubach, 1771, 363 p.
-
, Eloge historique de Monsieur Charles Guillaume Loys de Bochat, Lieutenant Baillival & Controleur Général à Lausanne, Lausanne : Antoine Chapuis, 1755, 56 p.
-
, Dissertatio juris gentium inauguralis, Marburgi Cattorum : Typis Phil. Casim. Muller, Acad. Typ, [1740], 76 p.
-
, Specimen methodi demonstrativae ad jus gentium applicatae, Marburgi Cattorum : apud Philippum Casimirum Mullerum, 1741, 76 p.
-
, Une passion amoureuse sous le regard de Voltaire: soixante-seize lettres de Charlotte Pictet à son mari, Samuel Constant de Rebecque (1755-1764), Pictet, François (éd.), Genève : Fondation des archives de la famille Pictet, 2015, 141 p.
-
, Traité philosophique des loix naturelles, où l'on recherche et l'on établit, par la nature des choses, les formes de ces loix, leurs principaux chefs, leur ordre, leur publication & leur obligation, Barbeyrac, Jean (trad.), Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1744
-
, Leçons de droit de la nature et des gens, par M. le Professeur de Félice, Yverdon : [F.-B. de Felice], 1769, 2 vol.
-
, Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens, Amsterdam : chez les Janssons à Waesberge, Wetstein & Smith, & Z. Chatelain : La Haye; chez P. de Hondt, la veuve de Ch. Le Vier, & J. Neaulme, 1739, 5 vol.
-
, Lettres diverses, recueillies en Suisse, accompagnées de notes et d'éclaircissements, Genève, Paris : J. J. Paschoud, 1821
-
, Le droit de la guerre et de la paix, Barbeyrac, Jean (trad.), Amsterdam : Pierre de Coup, 1724, 2 vol.
-
, De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur, Amstelaedami : apud Janssonio-Waesbergios, 1720
-
, Formulaire de consentement des églises réformées de Suisse. Sur la doctrine de la grâce universelle, & les matières qui s'y rapportent, comme aussi sur quelques autres articles, Barbeyrac, Jean, Barnaud, Barthélemy (trad.), [Amsterdam] : [s.n.], [1722], 135 p.
-
, Oratio inauguralis qua probatur dari Leges Naturales, Genevae : typis Fabri & Barrillot, 1719, 24 p.
-
, Ouvrages pour et contre les services militaires étrangers: considérés du côté du droit et de la morale tant par rapport aux souverains qui les autorisent ou les permettent, qu'aux particuliers qui s'y engagent, Lausanne, Genève : Marc-Michel Bousquet & Cie, 1738, 3 vol.
-
, De usu et praestantia juris naturalis oratio inauguralis, Genevae : apud Fabri et Barillot, 1720, 22 p.
-
, Opera omnia: recognita, aucta, emendata, multis in locis, atque in duos tomos distributa, Lugduni Batavorum : apud Joannem Arnoldum Langerak, 1735, 2 vol.
-
, Du pouvoir des souverains et de la liberté de conscience, en deux discours, Barbeyrac, Jean (trad.), Amsterdam : chez Thomas Lombrail, Marchand Libraire dans le Beursstraat, 1707
-
, Dissertation sur cette question: le Droit Naturel présente-t-il quelques principes sur la Procédure, Lausanne : Imprimerie de Hignou aîné, octobre 1824, 52 p.
-
, Dissertatio inauguralis De jure naturali, gentium et civili, Basileae : imprimebat Johannes Pistorius, 1734, 51 p.
-
, De officiis hominis et civis prout ipsi praescribuntur lege naturali, Giessae : sumptibus Joannis Philippi Krieger, 1731, 384 p.
-
, Le droit de la nature et des gens, ou système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence, et de la politique, Barbeyrac, Jean (trad.), Amsterdam : chez Gerard Kuyper, 1706, 2 vol.
-
, Les devoirs de l'homme et du citoyen, tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, Barbeyrac, Jean (trad.), Amsterdam : chez Henri Schelte, 1707, 376 p.
-
, Dissertatio juridica, de legibus civilibus in genere, exhibens earum naturam & indolem, introductionem, & necessitatem, Bernae : ex Officina Typogr. Illustr. Reipubl. Bernensis, 1740, 47 p.
-
, Hugonis Grotii jus belli et pacis, Francofurti : apud Johannem Davidem Zunnerum : Tyguri : [s.n.], 1689, 346 p.
-
, Jus naturae et gentium, ex Hugonis Grotii nobili, de bello et pace, Tiguri : typis Davidis Gessneri, 1694, 230 p.
-
, Hugo Grotius vom Kriegs- und Fridens-Recht/in welchem das Recht der Natur und der Völcker vorgestellet, Zürich : getruckt in der Gessnerischen Truckerey, 1718, 251 p.
-
, La philosophie de la liberté. Cours de philosophie morale, Lausanne : Georges Bridel, 1849, 2 vol.
-
, Mon utopie: nouvelles études morales et sociales, Lausanne : F. Payot : Paris : Félix Alcan, 1892, 303 p.
-
, Naturrecht nach den Vorlesungen von Dr. Wilh. Snell, gewes. Professor an den Universitäten zu Dorpat, Basel, Zürich und Bern. Hrsg. von einem Freunde des Verewigten, Bern : Kommissionsverlag der Buchhandlung Huber u. Comp. (J. Körber), 1859, 271 p.
-
, Discours contre la transubstantiation par feu Mr. Tillotson, Archev. de Cantorbery, traduit de l'anglois par Jean Barbeyrac, Barbeyrac, Jean (trad.), Amsterdam : Pierre Humbert, 1726, 68 p.
-
, Sermons sur divers Textes, prononcés en différentes occasions, Barbeyrac, Jean (trad.), Amsterdam : chez Thomas Lombrail, Marchand, 1706-1709, 3 vol.
-
, Sermons sur diverses matières importantes, Barbeyrac, Jean (trad.), Amsterdam : Thomas Lombrail : Pierre Humbert, 1708-1716, 5 vol.
-
, Abhandlung über die Frage: Beleidiget die Peinigung die Gerechtigkeit? und führt sie zu dem Endzweck, auf den die Gesetze zielen?, Bern : B. F. Fischer, 1785, 222 p.
-
, Défense du système leibnitien contre les objections et les imputations de Mr. de Crousaz, Leide : Elie Luzac, 1741, 592 p.
-
, Le loisir philosophique, ou, Pièces diverses de philosophie, de morale et d'amusement, Dresde : George Conrad Walther, 1747, 312 p.
-
, Amusements de littérature, de morale et de politique, La Haye : Pierre Gosse junior et Daniel Pinet, 1765, 109 p.
-
, Questions de droit naturel et Observations sur le Traité du Droit de la Nature de M. le Baron de Wolf, Berne : Société typographique, 1762, 439 p.
-
, Le droit des gens. Ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite & aux affaires des Nations & des Souverains, Londres [i.e. Neuchâtel] : [Abraham Droz], 1758, 2 vol.
-
, Dissertatio juridica inauguralis de postulando: seu de advocatis, Basileae : typis Friderici Ludovici Meyeri, 1737, 24 p.
-
, Praelectio de successione testamentaria ex jure naturali, civili & statutario, Bernae : ex Officina Typogr. Illustriss. Reip. Bernensis, 1748, 45 p.
-
, Traité du droit naturel, & de l'application de ses principes au droit civil et au droit des gens; Ouvrage posthume de Mr. Vicat, Docteur & Professeur en Droit à Lausanne, Lausanne : chez la Société typographique : Yverdon : chez la Société litt. et typograph., 1777, 4 vol.
-
, Institutiones iuris naturae et gentium in usum serenissimi principis Christiani Ludovici, Marchionis Brandenburgici &c. &c. ad methodum Hugonis Grotii, Halae Magdeburgicae : apud Joh. Frieder. Zeitlerum & Heinr., 1701
-
, Annotata atque exempla illustrantia in Samuelis L. B. de Pufendorf libros duos de officio hominis et civis adornata Labore & Studio, Basileae : impensis Eman. & Joh. Rod. Thurnisorium Fratrum, 1711, 354 p.
-
, Dissertation où l'on prouve le droit exclusif de la Compagnie Orientale des Provinces-Unies au commerce & à la navigation des Indes Orientales, Barbeyrac, Jean (trad.), La Haye : chez T[homas] Johnson, 1724, 22 p.
-
, « Pensées tirées du Traité sur le Droit de la Guerre, par M de Wattel, imprimé en 1758 », Journal helvétique, décembre 1763, p. 586-592
-
, « Lettre à Monsieur de Crousaz, Membre des Académies Royales des Sciences de Paris & de Bordeaux & Professeur à Lausanne, contre la Défense du système Leibnitien, par Monsieur Emer de Vattel », Journal helvétique, janvier 1747, p. 026-049
-
, « Ouvrages pour & contre les services militaires étrangers, considérés du côté du droit & de la morale, tant par rapport aux souverains qui les autorisent ou les permettent, qu'aux particuliers qui s'y engagent », Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savans de l'Europe, n° 21/2, octobre 1738-décembre 1738, p. 358-383
-
, « Ouvrages pour & contre les services militaires étrangers, considérés du côté du droit & de la morale, tant par rapport aux souverains qui les autorisent ou les permettent, qu'aux particuliers qui s'y engagent [suite et fin] », Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savans de l'Europe, n° 22/1, janvier 1739-mars 1739, p. 60-94
-
, « Extrait du Second Tome des Principes du Droit naturel, par feu Mr. Burlamaqui, Professeur en Droit & Conseiller d'Etat à Genève », Journal helvétique, avril 1754, p. 372-386
-
, « Extrait du Second Volume du Droit des Gens, par Mr. de Vattel », Journal helvétique, mai 1758, p. 510-549
Littérature secondaire
-
Christoff, Daniel et Stocker, Augustin (dir.), La philosophie à Lausanne XVIIIe - XXe siècle, Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire : IRL Impr. réunies, 1994, 92 p.
-
Parkin, John et Stanton, Timothy (dir.), Natural Law and Toleration in the Early Enlightenment, Oxford : Oxford University Press, coll. Proceedings of the British Academy 186, 2013
-
Huguenin, Séverine et Léchot, Timothée (dir.), Lectures du Journal helvétique, 1732-1782, Genève : Slatkine, coll. Travaux sur la Suisse des Lumières 18, 2016, 413 p.
-
Stelling-Michaud, Sven et Stelling-Michaud, Suzanne (dir.), Le livre du recteur de l'Académie de Genève: 1559-1878, Genève : Droz, coll. Travaux d'humanisme et de Renaissance 33, 1959-1980, 6 vol.
-
Zurbuchen, Simone (dir.), The Law of Nations and Natural Law 1625-1800, Leiden, Boston : Brill, coll. Early Modern Natural Law: Studies & Sources 1, 2019
-
, Libéralisme et société dans le canton de Vaud: 1814-1845, Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, coll. Bibliothèque historique vaudoise 67, 1980, 742 p.
-
Coleman, Patrick et alii (dir.) , Reconceptualizing Nature, Science, and Aesthetics. Contribution à une nouvelle approche des Lumières helvétiques, Genève : Slatkine, coll. Travaux sur la Suisse des Lumières 1, 1998, 271 p.
-
, Les portraits professoraux de la salle du sénat. Palais de Rumine, Lausanne : Université de Lausanne, coll. Etudes et documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne XVII, 1987, 150 p.
-
, Histoire de l'université de Genève. T. 1: L'Académie de Calvin (1559-1798), Genève : Georg, 1900, 662 p.
-
, Change of State: Nature and the Limits of the City in Early Modern Natural Law, Princeton : Princeton University Press, 2011
-
, Locke, Shaftesbury, and Hutcheson. Contesting Diversity in the Enlightenment and Beyond, Cambridge : Cambridge University Press, 2006
-
, De l'Académie à l'Université de Lausanne, 1537-1987. 450 ans d'histoire, [exposition au] Musée historique de l'Ancien-Evêché, Lausanne, Denges-Lausanne : Ed. du Verseau, 1987
-
Busino, Giovanni et alii (dir.) , Genève et la Suisse dans la pensée politique. Actes du XVIIIe colloque de Genève (2006), Aix-en-Provence : Presses Universitaires d'Aix-Marseille, coll. Collection d'histoire des idées politiques 18, 2007
-
, La ville de Fribourg de 1798 à 1814: Les municipalités sous l'Helvétique et la Médiation, une comparaison avec d'autres Villes-Etats de Suisse, Fribourg : Academic Press Fribourg, 2006
-
, Le mariage dans l'école romande du droit naturel au XVIIIe siècle, Genève : Librairie de l'Université Georg, coll. Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève 51, 1976, 164 p.
-
, Droits de l'homme, droit naturel et histoire: droit, individu et pouvoir, de l'Ecole du Droit naturel à l'Ecole du Droit historique, Paris : Presses universitaires de France, 1991, 280 p.
-
, Private and Public: Individuals, Households, and Body Politic in Locke and Hutcheson, London : [s.n.], 1992
-
, Impolite Learning: Conduct and Community in the Republic of Letters, 1680-1750, New Haven, London : Yale University Press, 1995, 395 p.
-
, Naturrechtliche Ansätze einer Menschenrechtsidee und des humanitären Völkerrechts im Zeitalter der Aufklärung, Zürich : Dike, 2011, 208 p.
-
, Les embarras philosophiques du droit naturel, Paris : J. Vrin, coll. Histoire des idées et des doctrines, 2003, 384 p.
-
, The Science of the Legislator. The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith, Cambridge : [s.n.], 1981
-
, Natural Law and Moral Philosophy: From Grotius to the Scottish Enlightenment, Cambridge : [s.n.], 1996
-
Haakonssen, Knud (dir.), Grotius, Pufendorf and Modern Natural Law, Aldershot : Ashgate/Dartmouth, coll. The International Library of Critical Essays in the History of Philosophy 1, 1999
-
, Jean Jacques Burlamaqui A Liberal Tradition in American Constitutionalism, Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1937, 216 p.
-
, Early modern natural law theories: contexts and strategies in the early Enlightenment, Dordrecht : Kluwer Academic Publ., 2003
-
, Rival Enlightenment: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany, Cambridge : Cambridge University Press, 2006
-
, Dictionnaire des professeurs de l'Académie de Lausanne (1537-1890), Lausanne : Université de Lausanne, 2005
-
, Naturrecht und Rechtsphilosophie im 19. Jahrhundert: eine Bibliographie, 1780 bis 1850, Tübingen : J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 2012
-
, Barbeyrac interprete di Pufendorf e Grozio: dalla costruzione della sovranità alla teoria della resistenza, Napoli : Ed. Scientifica, 2003, 706 p.
-
Raynoud, Philippe et Rials, Stéphane (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris : PUF, 1996
-
, La Théorie du droit naturel depuis le XVIIe siècle et la doctrine moderne, Paris : Hachette, 1928, 184 p.
-
, Jean Barbeyrac (1674-1744) et les débuts de l'enseignement du droit naturel dans l'ancienne Académie de Lausanne: contribution à l'histoire du droit naturel, Lausanne : F. Rouge, coll. Recueil de travaux de l'Université de Lausanne, 1937, 260 p.
-
, Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois qui se sont distingués dans leur pays ou à l’étranger, Lausanne : Georges Bridel, 1878, 2 vol.
-
, Gabriel Seigneux de Correvon, ein schweizerischer Kosmopolit, 1695-1775, Firenze : Tipografia Giuntina, coll. Biblioteca dell' "Archivum romanicum". Serie 1, Storia-letteratura-paleografia, 1947, 171 p.
-
, Berlin und die Verbreitung des Naturrechts in Europa: Kultur- und sozialgeschichtliche Studien zu Jean Barbeyracs Pufendorf-Uebersetzungen und eine Analyse seiner Leserschaft: mit einem Vorwort von Gerhard Oestreich, Berlin : W. de Gruyter, coll. Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin 30, 1970, 244 p.
-
, Inventaire des archives de la famille Clavel de Cully, Lausanne : Bibliothèque cantonale et universitaire, 1964, 133 p.
-
, Enemies of Mankind. Vattel's Theory of Collective Security, Leiden : Brill, coll. The Erik Castrén Institute Monographs on International Law and Human Rights 18, 2013, 252 p.
-
, The position of the individual in international law according to Grotius and Vattel, The Hague : M. Nijhoff, 1960, 260 p.
-
, Messieurs de la Justice et leur greffe: aspects de la législation, de l'administration de la justice civile genevoise et du monde de la pratique sous l'Ancien Régime, Genève : Société d'histoire et d'archéologie de Genève : Paris : Champion, coll. Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève 54, 1992, 223 p.
-
, Leibniz et l’école moderne du droit naturel, Paris : Presses universitaires de France, 1989, 236 p.
-
, Diritto naturale e volontà generale. Il contrattualismo repubblicano di Jean-Jacques Rousseau, Torino : Claudiana, 2010
-
, Roman Law in the State of Nature : The Classical Foundations of Hugo Grotius' Natural Law, Cambridge : Cambridge University Press, 2015
-
, 300 ans d'enseignement du droit à Lausanne, Genève : Schulthess, coll. Recherches juridiques lausannoises, 46, 2010, 441 p.
-
, Religion, Law and the Growth of Constitutional Thought (1150-1650), Cambridge : Cambridge University Press, 1982
-
, Natural Rights Theories: Their Origin and Development, Cambridge : Cambridge University Press, 1979
-
, The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant, Oxford : Oxford University Press, 1999
-
, A Discourse on Property. John Locke and his adversaries, Cambridge : Cambridge University Press, 1982
-
, An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts, Cambridge : Cambridge University Press, 1993
-
, Zwischen Physikotheologie und Positivismus. Pierre Prevost (1751-1839) und die korpuskularkinetische Physik der Genfer Schule, Frankfurt am Main : Lang, 1988, 467 p.
-
, Patriotismus und Kosmopolitismus: die Schweizer Aufklärung zwischen Tradition und Moderne, Zürich : Chronos, 2003, 199 p.
-
, Naturrecht und natürliche Religion: Zur Geschichte des Toleranzbegriffs von Samuel Pufendorf bis Jean-Jacques Rousseau, Würzburg : Königshausen & Neumann, coll. Epistemata Reihe Philosophie 82, 1991, 195 p.
-
, « De Berlin à Neuchâtel: la genèse du "Droit des gens" d'Emer de Vattel », in Schweizer im Berlin des 18. Jahrhunderts, Berlin : Akademie Verlag, 1996, p. 45-56
-
, « Die Freiburger Rechtsschule », in Schuster, Caroline et alii (dir.), Fribourg 1789: une révolution culturelle? / Freiburg 1798: eine Kulturrevolution?, Fribourg : Musée d'art et d'histoire, 1998, p. 181-187
-
, « La publication des "Principes du droit politique" de Burlamaqui », in Recueil de travaux publié par la Faculté de droit de l'Université de Genève, Genève : A. Kundig, 1938, p. 73-82
-
, « Vattel and the American Dream: An Inquiry into the Reception of the Law of Nations in the United States », in The Roots of International Law - Les fondements du droit international, Leiden : Brill, 2014, p. 251-300
-
, « Vattel et la sémantique du droit des gens: une tentative de reconstruction critique », in Vattel's International Law in a XXIst Century Perspective, Leiden : Brill, 2011, p. 388-433
-
, « Droit naturel et humanité chez Burlamaqui », in Jean-Jacques Burlamaqui, "Principes du droit naturel", Coujou, Jean-Paul (éd.), Paris : Dalloz, 2007, p. 205-481
-
, « L'ambivalence politique de la figure du contrat social chez Pufendorf et chez les fondateurs de l'Ecole romande du droit naturel », in Gesellschaftliche Freiheit und vertragliche Bindung in Rechtsgeschichte und Philosophie, Frankfurt : [s.n.], 1999, p. 35-74
-
, « Les ruses de la Raison d'Etat ou Histoire et Droit naturel dans l’œuvre et la pensée des Fondateurs du Droit naturel moderne », in Kroeschell, Karl (dir.), Festschrift für Hans Thieme zu seinem 80. Geburtstag, Sigmaringen : J. Thorbecke, 1986, p. 265-283
-
, « Droit canonique, droit civil », in IUS, Enseigner le droit à Fribourg 1763-2013. Actes du colloque des 13 et 14 juin 2013, Fribourg : Société d'histoire du canton de Fribourg, 2014, p. 139-149
-
, « Pufendorf et Grotius: deux faux amis ou la bifurcation philosophique des théories du droit naturel », in Samuel Pufendorf, filosofo del diritto et della politica, Napoli : [s.n.], 1996, p. 171-207
-
, « The Character and Obligation of Natural Law according to Richard Cumberland », in Stewart, M. A. (dir.), English philosophy in the age of Locke, Oxford : Clarendon Press, 2000, p. 29-74
-
, « German natural law », in Goldie, Mark et Wokler, Robert (dir.), Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought, Cambridge : Cambridge University Press, 2006, p. 251-290
-
, « Natural Law and Moral Realism », in Stewart, M. A. (dir.), Studies in the Philosophy of the Scottish Enlightenment, Oxford : Oxford University Press, 1990, p. 61-85
-
, « The language of sociability and commerce: Samuel Pufendorf and the theoretical foundations of the "Four-Stages-Theory" », in Pagden, Anthony (dir.), The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe, Cambridge : Cambridge University Press, 1987, p. 253-276
-
, « Some modern conceptions of natural law », in Crowe, Jonathan et Lee, Constance (dir.), Research Handbook on Natural Law Theory, Cheltenham : Edward Elgar, 2019, p. 105-128
-
, « Des origines coloniales du droit international. A propos du droit des gens moderne du 18ème siècle », in Dupuy, Pierre-Marie et Chétail, Vincent (dir.), The Roots of International Law / Les fondements du droit international: Liber Amicorum Peter Haggenmacher, Leiden : Brill, coll. Legal History Library / Studies in the History of International Law 11/5, 2013, p. 649-672
-
, « Die Philosophie der Gesetzgebung. Naturrecht und Rechtsphilosophie als Gesetzgebungswissenschaft im 18. un 19. Jahrhundert », in Dölemeyer, Barbara et Klippel, Diethelm (dir.), Gesetz un Gesetzgebung im Europa der frühen Neuzeit, Berlin : Duncker & Humblot, 1998, p. 225-247
-
, « Civil Sovereign and the King of Kings: Barbeyrac and the Creator's Right to Rule », in Hunter, Ian et Saunders, David (dir.), Natural Law and Civil Sovereignty: Moral Right and State Authority in Early Modern Political Thought, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2002, p. 109-122
-
, « Voluntarism and Moral Obligations: Barbeyrac's Defence of Pufendorf Revisited », in Hochstrasser, Tim et Schröder, Peter (dir.), Early Modern Natural Law Theories: Context and Strategies in the Early Enlightenment, London : Springer, 2003, p. 195-225
-
, « Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness. Human Rights in Barbeyrac and Burlamaqui », in Korkman, Petter (dir.), Transformations in Medieval and Early-Modern Rights Discourse, Dordrecht : Springer, 2006, p. 257-282
-
, « Grotius, droit naturel et religion naturelle », in Canziani, Guido et Zarka, Yves Charles (dir.), L'interpretazione nei secoli XVI e XVII, Milano : Franco Angeli, 1993, p. 487-514
-
, « L'état de guerre et la guerre entre les états: Jean-Jacques Rousseau et la critique du droit naturel », in Viallaneix, Paul et Ehrard, Jean (dir.), La bataille, l'armée, la gloire (1745-1871). Actes du colloque international de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand : Association des Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand, 1985, p. 135-148
-
, « Natural Law and the Pyrrhonian Controversy », in Jones, Peter (dir.), Philosophy and Science in the Scottish Enlightenment, Edinburgh : John Donald Publishers, 1989, p. 20-38
-
, « Gershom Carmichael and the Natural Jurisprudence Tradition in Eighteenth-Century Scotland », in Hont, Istvan et Ignatieff, Michael (dir.), Wealth and Virtue, The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge : Cambridge University Press, 1983, p. 73-87
-
, « Natural Sociability and Natural Rights in the Moral Philosophy of Gershom Carmichael », in Hope, Vincent (dir.), Philosophers of the Scottish Enlightenment, Edinburgh : University Press, 1984, p. 1-12
-
, « Natural rights in the Scottish Enlightenment », in Goldie, Mark et Wokler, Robert (dir.), The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought, Cambridge : [s.n.], 2006, p. 291-316
-
, « La leçon inaugurale de Jean Barbeyrac à l'Académie de Lausanne », in Collectif (dir.), Les grands juristes. Actes des journées internationales de la Société d'histoire du droit, Aix-en-Provence, 22-25 mai 2003, Aix-en-Provence : Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2006, p. 107-112
-
, « L'enseignement du droit naturel à celui du droit positif », in Collectif (dir.), L'enseignement du droit à l'Académie de Lausanne aux XVIIIe et XIXe siècles, Lausanne : Université de Lausanne, coll. Etudes et documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne 22, 1987, p. 5-52
-
, « Entre ristous, grippious et mitous », in Pichonnaz, Pascal et Steinauer, Jean (dir.), IUS, Enseigner le droit à Fribourg, 1763-2013. Actes de colloque, 13-14 juin 2013, Fribourg : Société d'histoire du canton de Fribourg, coll. Archives de la SHCF 15, 2014, p. 97-117
-
, « Burlamaqui und Genf », in Machtteilung: Geschichte der Mischverfassung, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 2006, p. 257-268
-
, « Liberty and Natural Rights in Pufendorf's Natural Law Theory », in Korkman, Petter (dir.), Transformations in Medieval and Early-Modern Rights Discourse, Dordrecht : Springer, 2006, p. 225-256
-
, « Guerre juste et droit de résistance dans la tradition protestante du droit naturel », in Poncelet, Christian et alii (dir.), Genève et la Suisse dans la pensée politique, Aix-en-Provence : Presses Universitaires d'Aix-Marseille, coll. Collection d'histoire des idées politiques 18 , 2007, p. 103-116
-
, « De Diderot à Rousseau: la double crise du droit naturel moderne », in Bachofen, Blaise et alii (dir.), Rousseau, Du contract social, ou Essai sur la forme de la République (Manuscrit de Genève), Paris : Vrin, 2012, p. 141-153
-
, « Vattel's Doctrine of National Sovereignty in the Context of Saxony-Poland and Neuchâtel », in Theory and Politics of the Law of Nations. Political Bias in International Law Discourse of Seven German Court Councilors in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Leiden : Brill, coll. Legal History Library / Studies in the History of International Law 5/2, 2011, p. 220
-
, « Grotius et Selden », in Henderson Burns, James (dir.), Histoire de la pensée politique moderne, 1450-1700, Paris : PUF, coll. Léviathan, 1997
-
, « The 'Modern' Theory of Natural Law », in Pagden, Anthony (dir.), The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe, Cambridge : Cambridge University Press, 1987, p. 99-120
-
, « Die Westschweizer Naturrechtsschule: Von Jean Barbeyrac zur Encyclopédie d'Yverdon », in Patriotismus und Kosmopolitismus. Die Schweizer Aufklärung zwischen Tradition und Moderne, Zürich : Chronos, 2003, p. 49-70
-
, « Théorie de la guerre juste et balance du pouvoir en Europe », in Kapossy, Béla et alii (dir.), L'Europe en province: la Société du comte de la Lippe (1742-1747). Actes du colloque organisé à l'Université de Lausanne, 25 et 26 juin 2009, Lausanne : Lumières.Lausanne, 2013
-
, « Das Naturrecht in der "Encyclopédie d'Yverdon" », in Candaux, Jean-Daniel et alii (dir.), L'Encyclopédie d'Yverdon et sa résonnance européenne. Contextes - contenus - continuités, Genève : Slatkine, coll. Travaux sur la Suisse des Lumières 7, 2005, p. 191-215
-
, « Emer de Vattel on the Society of Nations and the Political System of Europe », in Kadelbach, Stefan et alii (dir.), System, Order and International Law. The Early History of International Legal Thought from Machiavelli to Hegel, Oxford : Oxford University Press, 2017, p. 263-282
-
, « Eigenes und Fremdes im Völkerrecht der Frühen Neuzeit: Rechtfertigung und Kritik der Unterwerfung der Völker der Neuen Welt », in Altwicker, Tilmann et alii (dir.), Völkerrechtsphilosophie der Frühaufklärung, Tübingen : Mohr Siebeck, coll. Politika 12, 2015, p. 177-197
-
, « Das Verhältnis Europas zu den Staaten der Alten und Neuen Welt. Die Idee einer société générale du genre humain in Emer von Vattels Völkerrecht », in Asbach, Olaf (dir.), Europa und die Moderne im langen 18. Jahrhundert, Hannover : Wehrhahn Verlag, 2014, p. 167-188
-
, « Das Naturrecht in der französischen Schweiz », in Holzhey, Helmut (dir.), Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, Bd. 2. Frankreich, Basel : Schwabe, coll. Grundriss der Geschichte des Philosophie 18/2, 2008, p. 182-203, 210-212
-
, « Summarische Anweisung dessen so einem Patricio oder Politico zu Bern sonderlich zu wüssen nöthig », Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, n° 13, 1951, p. 53-54
-
, « The Reception of Pufendorf and Leibniz in the early "école romande du droit naturel": Jean Barbeyrac and Louis Bourguet », Etudes Lumières.Lausanne, n° 7, février 2019
-
, « Jean Barbeyrac's Theory of Permissive Natural Law and the Foundation of Property Rights », Journal of the history of ideas, n° 76 (4), 2015, p. 541-562
-
, « Pietro Giannone à Genève et la publication de ses œuvres en Suisse au XVIIIe et au XIXe siècles », Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, n° 3, 1963, p. 119-138
-
, « Centenaire de la naissance de Charles Secrétan », Revue de théologie et de philosophie, n° 25, novembre 1917-décembre 1917, p. 249-348
-
, « Fédor Golowkin sur les traces de Voltaire: genèse des "Lettres diverses recueillies en Suisse" », Revue Voltaire, n° 11, 2011, p. 265-271
-
, « Stoicism, Slavery and Law, Grotian Jurisprudence and Its Reception », Grotiana, n° 22, 2001, p. 197-231
-
, « The First Edinburgh Chair in Law - Grotius and the Scottish Enlightenment », Fundamina, 2005, p. 32-58
-
, « Pufendorf, sociality and the modern state », History of Political Thought, n° 17, 1996, p. 354-378
-
, « Les droits individuels et le corps social: Rousseau et Burlamaqui », Etudes Jean-Jacques Rousseau, n° 4, 1990, p. 9-29
-
, « Pufendorf on Morality, Sociability, and Moral Powers », Journal of the History of Philosophy, n° 50, 2012, p. 213-238
-
, « Rousseau's debt to Burlamaqui: The ideal of nature and the nature of things », Journal of the History of Ideas, n° 2, 2011, p. 209-230
-
, « Remarques sur la vie intellectuelle en Suisse au XVIIIe siècle par un chevalier de Malte », Revue historique vaudoise, n° 73, 1965, p. 81-91
-
, « Natural Law and Personhood: Samuel Pufendorf on Social Explanation », Max Weber Lectures Series, 2010
-
, « Natural Law and the Scottish Enlightenment », Man and Nature / L'homme et la nature, n° 4, 1985, p. 47-80
-
, « Conscience and Reason: The Natural Law Theory of Jean Barbeyrac », The Historical Journal, n° 36, 1993, p. 289-308
-
, « Pufendorf’s theory of facultative sovereignty : on the configuration of the sol of the state », History of Political Thought, n° 33, 2012, p. pp. 427-454
-
, « Vattel's Law of Nations : Diplomatic Casuistry for the Protestant Nation », Grotiana, n° 31, 2010, p. 108-140
-
, « Conflicting Obligations: Pufendorf, Leibniz and Barbeyrac on Civil Authority », History of Political Thought, n° 25, 2004, p. 670-699
-
, « Philo Judaeus and Hugo Grotius’s Modern Natural Law », Journal of the History of Ideas, n° 74, 2013, p. 339-359
-
, « Emer de Vattel's Mélanges de littérature, de morale et de politique (1760) », History of European Ideas, n° 34/1, 2008, p. 77-103
-
, « Vattel, la tradition du droit des gens et la question des peuples autochtones », Revue suisse d'histoire, n° 56, 2006, p. 387-409
-
, « The State of Nature and Commercial Sociability in Early Modern International Legal Thought », Grotiana, n° 31, 2010, p. 22-43
-
, « Carl Schmitt's Vattel and the "Law of Nations" between Enlightenment and Revolution », Grotiana, n° 31, 2010, p. 141-164
-
, « Farewell to Berlin. Two Newly Discovered Letters by Jean Barbeyrac (1674-1744) », History of European Ideas, n° 33, 2007, p. 305-320
-
, « Pufendorf disciple of Hobbes : The nature of man and the state of nature : The doctrine of socialitas », History of European Ideas, n° 33, 2008, p. 26-60
-
, « Jean Cramer et son précis de l'histoire du droit genevois (1761) », Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, n° 13, 1964, p. 13-87
-
, « Un savant d'autrefois: Ch.-G. Loys de Bochat, 1695-1754 », Revue historique vaudoise, n° 49, 1941, p. 29-33
-
, « Pufendorf on Natural Equality, Human Dignity, and Self-Esteem », Journal of the History of Ideas, n° 71, 2010, p. 39-62
-
, « Grotius and Pufendorf on the right of necessity », History of Political Thought, n° 26, 2005, p. 285-302
-
, « The Natural Jurisprudence of Jean Barbeyrac: Translation as an Art of Political Adjustment », Eighteenth-Century Studies, n° 36, 2003, p. 473-490
-
, « Unsociable Sociability and the Crisis of Natural Law : Michael Hissman (1752-1784) on the State of Nature », History of European Ideas, n° 41, 2015, p. 619-639
-
, « Justice, War and Inequality. The Unjust Aggressor and the Enemy of the Human Race in Vattel's Theory of the Law of Nations », Grotiana, n° 31, 2010, p. 44-68
-
, « Rousseau, Pufendorf and the Eighteenth-Century Natural Law Tradition », History of European Ideas, n° 36, 2010, p. 280-301
-
, « Dating the Manuscript of De Jure Praedae (1604-1608): What Watermarks, Foliation and Quire Divisions can tell us about Hugo Grotius' Development as a Natural Rights and Natural Law Theorist », History of European Ideas, n° 35, 2009, p. 125-193
-
, « Les Elémens du droit naturel de Burlamaqui et le "célèbre docteur en droit Jean-Marc-Louis Favre à Rolle" », Revue historique vaudoise, n° 120, 2012, p. 127-142
-
, « Rousseau’s Pufendorf: Natural Law and the Foundations of Commercial Society », History of Political Thought, n° 15, 1994, p. 373-402
-
, « Vattel's "Law of Nations" and Just War Theory », History of European Ideas, n° 4, 2009, p. 408-417
-
, « Vattel's "Law of Nations" and the Principle of Non-Intervention », Grotiana, n° 31, 2010, p. 69-84
-
, « Das Prinzip des Naturrechts in der école romande du droit naturel », Jahrbuch für Recht und Ethik, n° 12, 2004, p. 189-211
-
, « Teaching the Law of Nature and Nations in the Swiss Context », Etudes Lumières.Lausanne, n° 6, novembre 2018
-
, « Quel fondement aux droits naturels? Étude de la traduction française du "De jure naturae et gentium" de Samuel Pufendorf par Jean Barbeyrac », Etudes de lettres, n° 318, 2022, p. 105-128
-
, Jean-Jacques Burlamaqui et Emer de Vattel, les coryphées suisses du droit naturel et des gens, thèse de doctorat, Université de Toulouse, 1989 [ fiche du manuscrit ]
-
, Etat et gouvernement: les sources et les thèmes du discours politique du patriciat genevois entre 1700 et 1770, thèse de doctorat, Genève, 1990 [ fiche du manuscrit ]
-
, The Light of Conscience: Jean Barbeyrac on Moral, Civil and Religious Authority, thèse de doctorat, University of Sussex, septembre 2012 [ fiche du manuscrit ]
-
, "Un petit Etat désire de se bien limiter avec ses voisins, surtout quand ce sont de grands princes...". Contexte et acteurs du traité de limites de Paris de 1749: les travaux d'approche genevois (1719-1725), mémoire de licence/Master, Genève, 2003 [ fiche du manuscrit ]