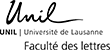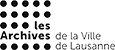Description du projet
La correspondance active du philosophe Jean Barbeyrac, qui a été professeur de droit à l'Académie de Lausanne entre 1711 et 1717, constitue à ce jour un corpus d'environ 210 lettres, conservées dans diverses archives européennes. Quelques lettres seulement ayant déjà fait l’objet d’une publication, il s’est avéré nécessaire d’en proposer une édition cohérente qui offre un nouvel éclairage aux chercheurs s’intéressant à l’histoire intellectuelle en Europe. Ces missives abordent des thématiques chères au philosophe: la théorie du droit naturel, la liberté dans les affaires de religion, sa participation aux débats politiques suisses ou encore son activité d’auteur et de savant à Berlin, Lausanne et Groningue. La vie quotidienne et familiale du professeur et homme de lettres se révèle aussi au travers des échanges épistolaires.
Cette correspondance permet non seulement d’approfondir nos connaissances sur Barbeyrac en tant que traducteur et citoyen respecté de la République des Lettres dans l’Europe des Lumières, mais aussi de mettre en perspective la théorie du droit naturel de ce savant et son engagement envers le protestantisme « rationnel ».
Jean Barbeyrac (1674- 1744): auteur et traducteur
Fils du pasteur Antoine Barbeyrac et de Madelaine de Gelly de Montagnac, Jean Barbeyrac naît à Béziers le 15 mars 1674 au sein d’une famille de la noblesse languedocienne. Suite à la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685, la famille se réfugie à Lausanne où le jeune Jean poursuit son éducation. Il suit le collège puis entre à l’Académie de Lausanne et y étudie le grec, l’hébreu, la philosophie et la théologie. Parallèlement, il suit un cours privé en droit naturel auprès du professeur Jean-Pierre de Crousaz. En 1693, après la mort de ses parents, Barbeyrac quitte le Pays de Vaud et continue ses études à Genève, devenant alors l’élève de Louis Tronchin, Benoît Calandrini et Benoît Pictet. Il termine son parcours académique à l’Université de Frankfurt-an-der-Oder où il obtient son diplôme en 1694.
La même année, Barbeyrac s’installe à Berlin où il occupe un poste d’enseignant au Collège français dès 1697. Il épouse en 1702 Hélène Chauvin, fille de l’un de ses amis et collègues, le pasteur Etienne Chauvin, d’origine huguenotte. Sa volonté de faire une carrière ecclésiastique étant compromise par des critiques l’accusant de socianisme, il se dirige vers la jurisprudence. Il se met à traduire en français les principales œuvres de Samuel Pufendorf : Le droit de la nature et des gens (De jure naturae et gentium, 1672) et Les devoirs de l’homme et du citoyen (De officio hominis et civis, 1673) paraissent respectivement en 1706 et 1707. Simultanément, il traduit deux ouvrages de Gerhardt Noodt : Du pouvoir des souverains, et de la liberté de conscience (De jure summi imperii et lege regia, 1699 ; De religione ab imperio iure gentium libera, 1706). En 1709, il publie son premier traité de morale, Traité du jeu, qu’il rééditera en 1737 dans une version augmentée.
En 1711, Barbeyrac est invité à l’Académie de Lausanne pour y occuper la première chaire de droit et d’histoire. Il y enseigne les principes du droit naturel à des jeunes gens destinés, pour la plupart, à des carrières politiques et ecclésiastiques. Pendant les six années passées à Lausanne, Barbeyrac publie plusieurs discours et des éditions revues et augmentées de ses deux traductions de Pufendorf. Il prend part activement à la vie intellectuelle romande et se fait notamment connaître pour son opposition à la Formula Consensus aux côtés de ses collègues lausannois Jean-Pierre de Crousaz et Georges Polier de Bottens et de son ami genevois Jean-Alphonse Turrettini.
Invité à reprendre la chaire de droit à l’Université de Groningue, Barbeyrac quitte Lausanne en 1717 pour ce poste plus prestigieux et mieux rémunéré. En Hollande, il reprend ses projets avec une motivation renouvelée. Il termine en 1720 son édition latine de De iure belli ac pacis (1625) de Hugo Grotius, ainsi que sa traduction commencée à Lausanne et publiée en 1724 : Le droit de la guerre et de la paix. Quatre ans plus tard, il publie son second traité, Traité de la morale des pères de l’Église (1728). L’année de sa mort paraît encore sa traduction du De legibus naturae (1672) de Richard Cumberland : Traité philosophique des loix naturelles (1744).
Parallèlement à ces différentes publications et traductions, Barbeyrac a été l’un des rédacteurs les plus actifs du périodique Bibliothèque raisonnée des savants de l’Europe, qui aborde principalement des sujets de théologie, d’histoire et des Belles-Lettres. Les articles étant anonymes, la correspondance et d’autres documents permettent de démontrer que plus de la moitié des comptes rendus d’ouvrages ou « extraits » parus pendant les premières années du périodique sont de sa plume. D’après les recherches de son biographe Philippe Meylan et de Bruno Lagarrigue, 122 articles pourraient lui être attribués. Six extraits de ses propres ouvrages y ont été publiés.
Droit naturel et République des Lettres
La théorie du droit naturel que Barbeyrac développe s’insère dans une tradition de penseurs de l’époque moderne qui ont cherché une solution au conflit entre religion et politique en établissant des normes fondées sur les principes de la raison naturelle. La reconnaissance de l'autorité divine est le fondement de l'ordre moral établi dans la plupart des théories du droit naturel. Un désaccord important a opposé les théoriciens au sujet de l'étendue des droits naturels et des devoirs de l'homme, de la relation entre l'humanité et Dieu, et du pouvoir exercé par l'Eglise et l'Etat. Dans le contexte suisse, Barbeyrac est l'un des principaux fondateurs de l'Ecole romande du droit naturel qui a diffusé les idées relatives au droit naturel auprès d’un public francophone fortement imprégné des principes du christianisme rationnel.
Bien qu’encouragé par ses correspondants à produire son propre traité sur le droit naturel, Barbeyrac a préféré développer sa théorie dans les notes qui accompagnent ses traductions. Il pouvait par ce biais présenter sa propre synthèse des théories du droit naturel de Pufendorf et de Grotius, une synthèse influencée par les idées du philosophe anglais John Locke et du penseur huguenot Pierre Bayle. L'originalité de Barbeyrac se trouve dans sa façon de développer, à partir de cette synthèse, des idées propres à sa théorie du droit naturel, caractérisée par un engagement de la liberté individuelle de conscience. Tout au long du XVIIIe siècle, les commentaires de Barbeyrac seront débattus aux côtés des œuvres originales de Grotius et de Pufendorf, notamment par Voltaire et Rousseau.
La diffusion des connaissances était chère à Barbeyrac et a influencé son travail à bien des égards. Dans son discours inaugural à l’Académie de Lausanne en 1714, il défend l’importance de la République des Lettres, constatant que l’influence des lettres et des sciences sont un grand atout pour toute société, et que même ceux qui n’y participent pas directement pourront en bénéficier par des échanges entretenus avec l’élite intellectuelle. Ce réseau savant international restera son principal public, ou plutôt son espace de dialogue privilégié. Les lettres de Barbeyac révèlent comment il a contribué concrètement au développement de la République des Lettres. Elles témoignent des nombreux échanges d’ouvrages entre lui et ses correspondants. Il demande régulièrement l’avis de ses pairs sur ses propres écrits et propose le sien quand il est sollicité. Les publications en cours et projets de traduction sont des thèmes qui reviennent souvent sous la plume du savant.
Etat de la recherche
Plus de 210 lettres adressées à 27 correspondants ont pu être identifiées dans diverses archives et bibliothèques européennes, principalement en Suisse, en Angleterre, en France et en Hollande. Elles couvrent la période des quarante dernières années de la vie de Barbeyrac, soit de 1702 à 1743.
Les 75 lettres mises en ligne en 2017 sont adressées au Genevois Jean Le Clerc (1 lettre: 1706), au Franco-anglais Pierre Desmaiseaux (13: 1706-1719), au Neuchâtelois Louis Bourguet (8: 1716-1717), aux Lausannois Jean-Pierre de Crousaz (16 : 1718-1839) et Charles Guillaume Loys de Bochat (1: 1721), au Français Charles Pacius de La Motte (36: 1730-1743), qui réside à Amsterdam. En février 2024, ont été mises en ligne les lettres adressées au Genevois Jean-Alphonse Turrettini (108: 1707-1736), intellectuel avec lequel Barbeyrac a le plus correspondu, ainsi que diverses missives adressées au médecin hollandais Theodoor Jansson van Almeloveen (3: 1710), au savant zurichois Johann Jacob Scheuchzer (6: 1714-1716), à Jacques-Philippe D'Orville (4: 1737-1741), professeur à l'Université d'Amsterdam, et à quelques autres personnalités. Trois brouillons de lettres conservés à la Bibliothèque royale de La Haye ont été aussi édités: le premier est adressé à l'Académie des sciences de Berlin (1713), le second à l'Université de Groningue concernant son engagement, suivi de sa lettre de démission de l'Académie de Lausanne au printemps 1717. Cinq lettres identifiées par Philippe Meylan n'ont pas pu être retrouvées en archives.
Concernant les lettres adressées à Jean-Alphonse Turrettini, voir le site https://humanities.unige.ch/turrettini/ qui fournit les résumés, l'identification des personnes et des ouvrages cités, ainsi que les scans des lettres. La fiche biographique consacrée à Barbeyrac signale aussi toutes les mentions de ce dernier dans la correspondance du Genevois.
Ligne éditoriale
L’édition proposée ici est une transcription diplomatique, complétée par certaines adaptations éditoriales comme la séparation des mots agglutinés, le rétablissement de certaines abréviations. Les biffures minimes (1-2 caractères) n’ont pas été reportées. Les éditeurs ont adaptés les noms propres à l’orthographe moderne, sauf lorsque la personne ou le lieu n’a pas pu être clairement identifié. La ponctuation n’a pas fait l’objet d’une modernisation, les soulignements ont été maintenus. L’écriture de Barbeyrac, lisible et régulière, ne présente pas de difficultés particulières, ses brouillons exceptés.
Remerciements
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre une équipe finlandaise, composée de Petter Korkman, de Taina Pierrier et de Meri Päivärinne de l’Université de Helsinki, et l’équipe de Lumières.Lausanne. Nous remercions particulièrement Meri Päivärinne de nous avoir laissé une première version des transcriptions des lettres, ainsi que la chercheuse Fiammetta Palladini pour la transcription des lettres rédigées en latin. Les chercheurs Sophie Bisset (Université du Sussex) et Damiano Bardelli (UNIL), de même que les étudiants-assistants Lucas Bonvin (UNIL) et Natacha Monnet (UNIL) les ont adaptées aux standards de Lumières.Lausanne. Séverine Huguenin a achevé le travail de collection entamé par l’équipe finlandaise et a assuré la relecture des 75 premières lettres en ligne; Béatrice Lovis a finalisé les quelque 130 lettres restantes qui ont été publiées en 2024. L’importante bibliographie primaire et secondaire rattachée au projet a été introduite par Damiano Bardelli.
Nous remercions également les institutions dépositaires des manuscrits, la Bibliothèque de la Société de l’Histoire du Protestantisme français, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, la British Library, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, les Archives de la Ville de Lausanne, The Hague Royal Library ainsi que la University Library d’Amsterdam. Enfin nos remerciements vont à la Faculté des lettres et au Centre des Sciences historiques de la culture de l’Université de Lausanne pour leur soutien financier.
Citer comme
Lumières.Lausanne, projet "Correspondance Barbeyrac (1702-1743)", dirigé par Séverine Huguenin, Béatrice Lovis et Béla Kapossy, Université de Lausanne, url: https://lumieres.unil.ch/projets/barbeyrac, mis en ligne le 29 mai 2017, version du 12 février 2024.