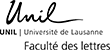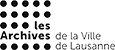Description du projet
Publié sans interruption de 1732 à 1782, le Mercure suisse – qui prendra successivement le titre de Journal helvétique, de Nouveau journal helvétique et de Journal de Neuchâtel – est un périodique qui a connu une exceptionnelle longévité. Témoin et acteur de la vie culturelle et intellectuelle, il permet la diffusion et la promotion des idées et des savoirs. En dehors des nombreux rédacteurs anonymes, ses contributeurs comptent des savants et des hommes de lettres illustres de Neuchâtel, Genève, Berne, Lausanne, Bâle ou Zurich, ainsi que des correspondants étrangers. Répondant aux attentes d'un public large, le Journal helvétique adopte une vocation multifonctionnelle: c'est une gazette littéraire, scientifique et politique, qui se présente comme un lieu privilégié de l'esprit critique, de débats savants et de création poétique.
De Louis Bourguet à Henri-David Chaillet
Louis Bourguet, le fondateur du Mercure suisse, édite celui-ci pendant dix ans, jusqu'à sa mort en 1742. Ce savant cosmopolite français, fils de réfugié huguenot, possède un réseau de correspondants d'envergure européenne, qui inclut des personnalités comme Leibniz et Réaumur. Naturaliste, numismate, philosophe et grand connaisseur des langues anciennes, il offre des contributions très variées au périodique. De 1767 à 1769, un autre grand acteur de la vie intellectuelle en Suisse francophone prend en charge la rédaction des articles : l'encyclopédiste et imprimeur Fortunato Bartolomeo De Felice. Plus tard, Jean-Élie Bertrand et la Société typographique de Neuchâtel (STN) assument la rédaction et l'impression du journal, avec le désir essentiel de promouvoir, à travers lui, l'ensemble de la production littéraire suisse, tout en marquant une ouverture vers la France par l'effort de s'attacher des correspondants parisiens. À la mort de Jean-Élie Bertrand (1779), le pasteur neuchâtelois Henri-David Chaillet offre au Journal helvétique des critiques littéraires indépendantes et fines, qui lui attirent une certaine renommée jusque dans les salons parisiens.
Les éditeurs successifs contribuent à redéfinir le contenu du journal, à en remodeler la structure et à saisir l'évolution du lectorat et de ses attentes. Ils rédigent eux-mêmes la plus grande partie des articles. Mais ces personnalités ne sont pas seules à produire des textes. Les nouvelles politiques sont souvent des articles de seconde main, empruntées à d'autres périodiques européens. Parmi les contributeurs occasionnels, on rencontre le botaniste et poète neuchâtelois Jean-Laurent Garcin, le journaliste français Grimod de la Reynière, Voltaire, le magistrat et publiciste vaudois Gabriel Seigneux de Correvon, le naturaliste et pasteur à Berne Élie Bertrand, le juriste neuchâtelois Emer de Vattel, l'abbé Prévost, le marquis d'Argens, le mathématicien bâlois Daniel Bernoulli, l'écrivain français Baculard d'Arnaud, le juriste genevois Jean-Jacques Burlamaqui, le philosophe lausannois Jean-Pierre de Crousaz, le médecin et poète bernois Albert de Haller, le juriste lausannois Charles-Guillaume Loys de Bochat, l'éditeur calviniste genevois Jacob Vernet, et bien d'autres. Quant au lectorat, il est loin de regrouper les seuls membres de l'élite savante. Les lettres de lecteurs et de lectrices témoignent de sa grande diversité. C'est que le Journal helvétique cherche à satisfaire les goûts et les attentes du plus grand nombre.
Lieu de réception des idées et des oeuvres des Lumières européennes, lieu d'échange intellectuel des Lumières suisses, le Journal helvétique est un médiateur culturel qui participe à l'élaboration des normes du jugement esthétique et moral, et qui permet de cerner, dans la Suisse du XVIIIe siècle, les pratiques de pensée en société.
État de la recherche et perspectives
Le Journal helvétique n'a fait l'objet que d'un nombre limité de travaux, souvent partiels ou déjà anciens. Une partie de ces études présente, à la suite de Gonzague de Reynold, le Journal helvétique comme le principal organe de promotion de l'helvétisme, entendu comme l'expression du patriotisme de l'époque. Or ce point de vue mérite aujourd'hui un réexamen. En effet, les principaux rédacteurs du Journal helvétique – et notamment son fondateur Louis Bourguet – sont moins les chantres d'un sentiment national que des savants cosmopolites intégrés dans les réseaux d'une République des lettres qui transcende les territoires nationaux.
En dehors de cette approche helvétiste, le journal a souvent été déconsidéré, son contenu paraissant trop médiocre pour susciter de l'intérêt. Un tel point de vue doit sans doute beaucoup aux critiques que le journal essuie, dès le XVIIIe siècle, de la part d'écrivains influents. Jean-Rodolphe Sinner de Ballaigues, l'auteur d'un Voyage historique et littéraire en Suisse occidentale, reproche au Journal helvétique ses mauvais jeux d'esprit qui, dans chaque livraison, paraissent sous la forme d'énigmes ou de logogriphes. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, regrette dans ses Lettres écrites de la montagne qu'on trouve la critique de ses ouvrages dans « le fumier du Mercure de Neuchâtel ». À leur suite, Philippe Godet et Virgile Rossel considèrent que les pièces en vers proposées par le périodique pendant toute la durée de son existence sont irrémédiablement mauvaises, en dehors d'une poignée d'exceptions. Ces points de vue dépréciatifs seront persistants.
Cependant, depuis une trentaine d'années, le Journal helvétique est l'objet de quelques études ponctuelles et ciblées de la part d'historiens comme Jean-Daniel Candaux et Michel Schlup, et de littéraires comme Rodolphe Zellweger ou Alain Cernuschi, qui mettent en évidence la richesse d'une telle source et la diversité de ses exploitations possibles. Il restait à porter un regard d'ensemble sur le périodique pour comprendre, dans toute sa complexité, son double rôle de vecteur et acteur culturels à travers ses cinquante années d’existence. Pour ce faire, un colloque international s'est tenu à Neuchâtel, du 6 au 8 mars 2014, réunissant des chercheurs issus de différents horizons scientifiques et intellectuels (littérature, histoire des sciences, histoire de la médecine, philosophie). Fruit de ce colloque, un livre rassemble désormais seize contributions originales dans un esprit d’interdisciplinarité. Saillantes ou méconnues, plusieurs facettes de ce journal sont revisitées. Elles offrent de nouvelles clefs de lecture et une vue d’ensemble des mutations qui, au fil des décennies, ont modelé le périodique : celui-ci est notamment abordé sous l’angle de sa formule éditoriale, de ses contenus et de ses publics. Une introduction substantielle à l’histoire du Mercure suisse /Journal helvétique complète ce volume et la gamme des outils aujourd'hui à la disposition de ses lecteurs.
Index des premières années (1732-1747)
Les index ci-dessous ont été élaborés dans les années 1990 par Jean-Daniel Candaux, chargé de recherche à la Bibliothèque de Genève, dans le cadre d’un projet du Fonds national suisse concernant l’ensemble des périodiques parus en Suisse, des origines à 1750. Il constitue donc le pendant pour la Suisse francophone du volume de Hanspeter Marti et Emil Erne, Index der deutsch- und lateinsprachigen Schweizer Zeitschriften von den Anfängen bis 1750 (Bâle, Schwabe, 1998). Comme ce dernier, il comporte un relevé des articles dans l’ordre chronologique de leur parution, ainsi que plusieurs index onomastiques et thématiques, renvoyant aux numéros du relevé chronologique. On y a joint un petit index des incipit des pièces en vers. La numérisation et la mise en ligne des fichiers offrent désormais aux utilisateurs un accès aisé à cet ensemble d’index.
Tables des matières: articles du Mercure suisse (1732-1747) et du Journal helvétique (1738-1747);
Index: des auteurs, onomastique, géographique, des matières, des publications annoncées, des incipit des pièces en vers.
Dépouillement
Le dépouillement intégral du Journal helvétique a été réalisé pour la période 1738-1769. Il a été effectué par des étudiants dans le cadre d'un séminaire niveau master en 2009. Les fiches ont été ensuite complétées par Kaïko Goren, Julien Sahli et Ekin Arikök, civilistes, et vérifiées par Béatrice Lovis. Il est possible que certaines d'entre elles soient encore fautives ou incomplètes. Nous vous remercions par avance de nous en avertir. → Recherche avancée
La numérisation de l'ensemble des livraisons du journal n'est accessible que pour les utilisateurs possédant un compte (obtenir un compte).
Remerciements
Nos remerciements chaleureux vont à Béatrice Lovis pour sa collaboration au projet d'inventaire du périodique et sa grande disponibilité. Nous remercions également Jean-Daniel Candaux qui nous a transmis les index relatifs aux premières décennies du journal. Finalement, ce projet, mené par Séverine Huguenin et Timothée Léchot sous la direction de Claire Jaquier (Université de Neuchâtel) et Béla Kapossy (Université de Lausanne), a bénéficié d'un subside du Fonds national suisse de la recherche scientifique, institution que nous souhaitons également remercier ici.
Citer comme
Lumières.Lausanne, projet "Mercure suisse - Journal helvétique (1732-1782)", dirigé par Séverine Huguenin et Timothée Léchot, Université de Lausanne, url: https://lumieres.unil.ch/projets/journal-helvetique, mis en ligne en 2013, version de juillet 2024.